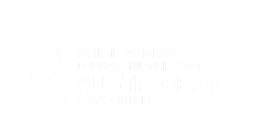Nos missions

Nos missions
Mares
Mares Les mares font partie du paysage Seinomarin depuis longtemps. Creusées par l’homme, elles permettaient, en absence de sources ou rivières, d’avoir une réserve d’eau à proximité. Au 19ème siècle,…

Nos missions
Urbanisme
Urbanisation résiliente Le SMBVAS vous accompagne dans la non-aggravation du risque inondation et l’adaptation au changement climatique. Au cours des 20 dernières années, le nombre de constructions a fortement augmenté…

Nos missions
Hydraulique
Ouvrage hydraulique et gestion de crise Le SMBVAS place au centre de ses actions la protection des biens et des personnes. Après avoir construit plus de 50 ouvrages sur le…

Nos missions
Culture du risque
Culture du risque Si la mémoire du risque disparait, le risque, lui, est toujours présent. Ce sont souvent les comportements inadaptés qui sont la principale cause de décès lors d’inondations.…

Nos missions
Agriculture
Développement durable du territoire rural Notre territoire connait depuis plusieurs dizaines d’années une forte évolution en termes de pratiques agricoles : disparition des herbages au profit des cultures, agrandissement des…

Nos missions
Rivière et zones humides
Rivière et zones humides Gérer les cours d’eau pour s’assurer de leur bon état : voici la mission du SMBVAS sur l’Austreberthe et le Saffimbec. Depuis 2022 et suite à…