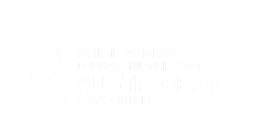Le CERT
Le Centre Eau Risque et Territoire
Le Centre Eau Risque et Territoire accueille depuis Juin 2018 le grand public, les professionnels et les scolaires pour les sensibiliser au risque inondation et à la préservation des milieux aquatiques. Situé en zone inondable, il est une maison témoin de l’adaptation au risque.